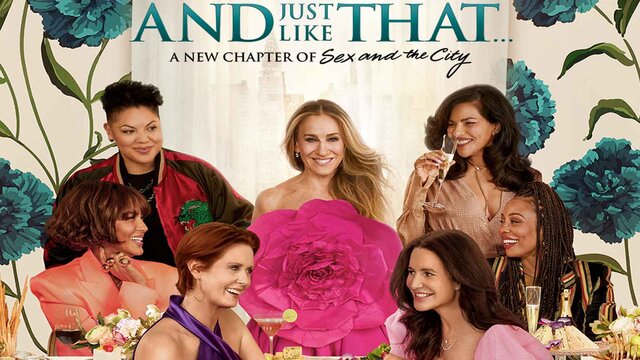GREENHOUSE (2024) – Critique
Fiche technique :
- Date de sortie : 29 mai 2024
- De : Sol-hui Lee
- Avec : Seo-Hyeong Kim,Jae-sung Yang,So-yo Ahn
- Genre : Thriller
- Durée : 1h40
Notre avis sur le film
GREENHOUSE
Le film s’ouvre sur le personnage de Moon-Jung qui se lève le matin, fait sa petite toilette et aussitôt commence à se gifler le visage. Ça y est le décor est planté, plus de doute possible, nous sommes bien en plein dans le cinéma coréen avec son lot de personnages meurtris et GREENHOUSE ne va pas déroger à la règle.

Premier film pour la jeune réalisatrice Lee Sol-hui (seulement 30 ans), GREENHOUSE suit le quotidien de Moon-Jung, une aide-soignante à domicile qui ne vit que pour son fils mineur incarcéré, pour un crime inconnu et bientôt libérable. Pour cela, le jour, elle s’occupe non sans relâche, d’un vieux monsieur aveugle et de sa femme, atteinte de démence. De nature bienveillante, elle supporte avec beaucoup de patience le comportement agressif et imprévisible de la vieille dame, qui l’accuse sans cesse de vouloir la tuer. Heureusement, elle peut toujours compter sur le soutien et la gentillesse du mari, qui la considère comme sa fille et se montre chaque jour reconnaissant de son soutien, compensant l’absence d’un fils bien plus obsédé par sa carrière que par le sort de ses parents.
Son travail terminé, elle rentre dans sa maison de fortune, une serre isolée au milieu de nulle part, qui ne nous manquera pas de rappeler celle du film BURNING de Lee Chang-Dong. Elle y loge en attendant d’avoir suffisamment d’économies pour pouvoir emménager avec son fils dans un appartement.
Alors qu’elle essaye de gérer au mieux la pression du quotidien avec ses différents personnages imprévisibles, un accident va se produire brutalement au domicile des deux retraités. Bientôt Moon-Jung va se retrouver avec un nouveau problème à régler seule : un corps…

Un projet personnel pour un thème universel
La mère de Lee Sol-hui s’est occupée de sa grand-mère atteinte de démence et le film est inspiré de cette relation :
« Alors qu’elle aimait pourtant travailler bénévolement, elle trouvait ça très difficile lorsqu’il s’agissait de sa propre mère. C’est en observant cette relation très intime que m’est venue l’histoire du film », précise la réalisatrice.
La question de la prise en charge des personnes âgées est un thème récurrent dans le cinéma coréen, et GREENHOUSE l’aborde tout en pointant la condition des laissés-pour-compte en Corée du Sud. La réalisatrice précise cependant qu’elle ne voulait pas traiter la thématique de l’accompagnement de la vieillesse comme l’histoire de quelqu’un d’autre ou comme une histoire qui concernerait uniquement la Corée, mais plutôt dans ce que ce sujet a d’universel.
Un thriller qui n’a pas grand-chose d’un thriller ordinaire
Dans le domaine du thriller qui fut jadis un genre exclusif et maitrisé à la perfection par le territoire de l’oncle Sam, les Coréens sont depuis plusieurs années devenus des maîtres dans le genre dans l’utilisation du suspense et des codes du polar. Pourtant GREENHOUSE n’a rien d’un polar musclé à l’instar d’un OLD BOY de Park Chan-wook, ne tient rien de la violence extrême d’un J’AI RENCONTRÉ LE DIABLE de Kim Jee-woon, et n’a rien du scénario millimétré de MEMORIES OF MURDERS de Bong Joon-jo. On est ici face à un thriller qui n’a pas grand-chose d’un thriller ordinaire. À partir de l’évènement tragique, une atmosphère plus sombre va cependant se développer, menant le film du drame psychologique au drame social en saupoudrant le tout d’une touche de comédie noire presque ironique.
La réalisatrice fait le choix de la pudeur, à la fois dans son scénario comme dans la mise en scène. Cette approche que l’on pourrait presque qualifier de minimaliste, a toutefois l’inconvénient de ternir ou d’amoindrir toutes formes d’émotion, dont on n’aurait pas boudé notre plaisir. Le film est empreint de légèreté ne créant que (trop) peu d’émoi.

Entre douceur, bienveillance, tourmente, violence, et destruction, GREENHOUSE parvient à dresser une critique sur la notion de responsabilité et la manière dont la société arrive à transformer des individus de prime abord ordinaires en personnages troublants s’égarant dans la folie.
Un film à découvrir en DVD et Blu-Ray dès le 1er octobre.
Lien d’achat du titre auprès d’HANABI : bit.ly/greenhouse-dvd
Par Sébastien NIPPERT
© 2022 KOREAN FILM COUNCIL. ALL RIGHTS RESERVED