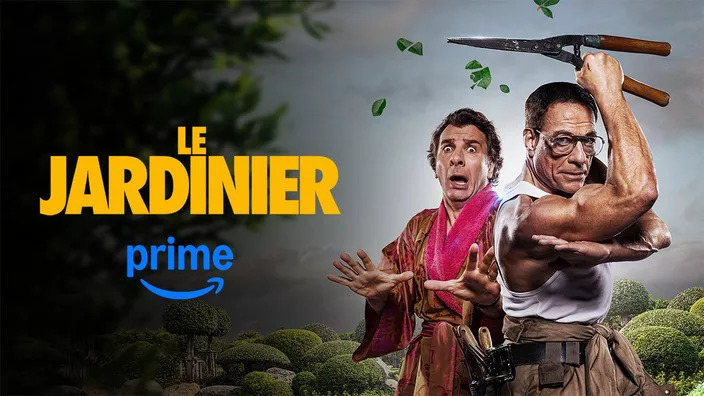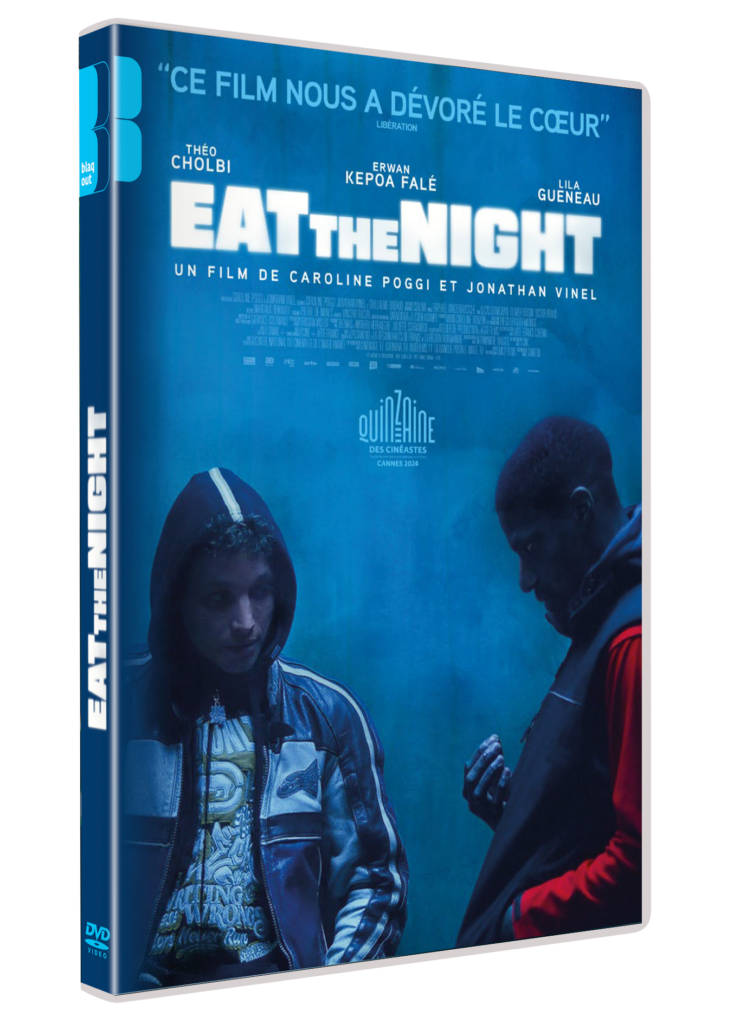NUMÉRO 24 (2025) – Critique
Fiche technique :
- Date de sortie : 1 Janvier 2025
- De : John Andreas Andersen
- Avec : August Wittgenstein,Lisa Loven Kongsli
- Genre : Biopic, Guerre
- Durée : 1h51
Notre avis sur le film
NUMÉRO 24

Synopsis officiel :
À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, la détermination d’un jeune Norvégien à résister aux nazis change la donne pour son avenir et celui de son pays (inspiré d’une histoire vraie).

La critique :
Le devoir de mémoire est important et le cinéma a toujours contribué à ce devoir. Netflix signe ici un de ses meilleurs films et peut être sa meilleure contribution au respect de notre histoire.
Vous aurez deux histoires en parallèle, celle du personnage principal racontant sa vie de résistant face à une classe d’étudiant parfois pétris de certitudes et donneurs de leçons et in fine ayant vraiment besoin de ce rappel historique, et la seconde histoire, celle du jeune homme qui ne peut vivre sa jeunesse et devra faire des choix dramatiques pour résister à la pire obscurité que va affronter son pays.
Ce film est sans tabou et aborde tous les sujets de la résistance : héroïsme, trahison, choix humainement impossible et surtout le devenir de l’humanité.
En rendant hommage à ce héros si peu connu et en mettant ses actions en parallèle aux dilemmes de la jeunesse actuelle, Netflix et le réalisateur John Andreas Andersen nous interrogent directement sur notre vision de cette période et nous confrontent à un choix difficile et que nous espérons ne jamais avoir à faire : en tant de guerre, qu’aurions nous fait ?

En Conclusion :
Magnifiquement réalisé, parfaitement interprété et posant avec pudeur mais détermination les questions nécessaires à notre devoir de mémoire, N°24 est peut-être l’œuvre la plus puissante produite par Netflix.
Par Grégory Caumes
|Copyright Netflix